
 Cet article traite du suicide des agents pénitentiaires et examine le taux élevé de suicides chez les agents pénitentiaires travaillant pour le Massachusetts Department of Correction (MADOC) entre 2010 et 2015.
Cet article traite du suicide des agents pénitentiaires et examine le taux élevé de suicides chez les agents pénitentiaires travaillant pour le Massachusetts Department of Correction (MADOC) entre 2010 et 2015.
Entre 2010 et 2015, au moins 20 agents pénitentiaires travaillant pour le Massachusetts Department of Correction (MADOC) sont décédés par suicide. Le taux de suicide moyen des agents pénitentiaires du MADOC au cours de cette période était d’environ 105 pour 100 000 – un taux au moins sept fois supérieur au taux de suicide national (14 pour 100 000), et presque 12 fois supérieur au taux de suicide pour l’État du Massachusetts (9 pour 100 000). Certains comtés du Massachusetts ont également signalé la perte de plusieurs agents pour cause de suicide au cours de la même période, ce qui laisse penser que le phénomène observé dans les prisons de l’État se répercute dans les établissements correctionnels des comtés. Même dans le contexte de l’augmentation des taux de suicide dans tout le pays, et compte tenu du risque élevé de suicide dans les services de protection, le nombre de suicides parmi les agents pénitentiaires du Massachusetts est déconcertant.
Notre équipe de recherche de la Northeastern University a d’abord appris l’existence d’un nombre croissant de suicides lors d’entretiens avec des officiers et des sergents qui participaient à une étude sur le stress professionnel. Au cours de ces entretiens, un certain nombre d’officiers ont fait part de leur inquiétude concernant les récents suicides de leurs collègues, et plusieurs d’entre eux ont indiqué qu’ils ne participaient à l’étude sur le stress que parce qu’ils étaient préoccupés par ces suicides. Nous avons dû interrompre temporairement les entretiens dans l’un des établissements pénitentiaires lorsque nous avons appris qu’un autre agent qui y travaillait venait de se suicider. À peu près à la même époque, un programme d’information local de la chaîne Fox a diffusé plusieurs reportages sur l’augmentation du nombre de suicides d’agents au MADOC, en mettant en scène certaines des familles des agents décédés.
Prévention du suicide
En tant que chercheurs universitaires travaillant déjà avec un service correctionnel de l’État motivé pour s’attaquer aux suicides qu’ils considéraient eux aussi comme un problème croissant, nous avons demandé au MADOC de nous fournir davantage d’informations. Nous pensions pouvoir déceler un modèle identifiable dans les données fournies. Nous avons été surpris de constater qu’il n’y avait rien d’évident. Les agents décédés entre 2010 et 2015 comprenaient des hommes et des femmes, à peu près proportionnellement à leur représentation dans la force de travail (qui est dominée par les hommes). Ils étaient âgés de 23 à 62 ans et avaient fait des carrières dans des établissements pénitentiaires allant de six mois à 32 ans. Moins de la moitié d’entre elles avaient un passé militaire. Parmi les personnes décédées par suicide, on trouve des officiers, des sergents, des lieutenants et des capitaines. Plusieurs d’entre eux avaient occupé le poste de directeur adjoint ou un poste plus élevé. La plupart des 16 prisons de l’État ont connu au moins un suicide d’officier, une poignée d’entre elles ayant connu plusieurs suicides. Certaines années, il y a eu quatre ou cinq suicides. Les seules caractéristiques extérieures évidentes que ces agents avaient en commun étaient qu’ils travaillaient tous à l’époque, ou avaient travaillé, pour le MADOC, et qu’ils étaient tous morts par suicide.
En 2016, mon collègue Carlos Monteiro et moi-même avons reçu une subvention fédérale du National Institute of Justice pour travailler avec le MADOC à la réalisation d’une vaste étude de méthodes mixtes sur le suicide dans les établissements pénitentiaires. Nous avons défini cinq objectifs principaux pour ce travail :
- Développer une compréhension nuancée du contexte dans lequel le suicide des agents s’est produit ;
- Évaluer de manière exhaustive les nombreux impacts du suicide des agents correctionnels sur les familles, les amis et les collègues ;
- Mieux comprendre l’impact des suicides d’agents sur l’environnement institutionnel ;
- Identifier les corrélats (et les facteurs de risque) de l’anxiété, de la dépression, du stress post-traumatique et des idées suicidaires ;
- et Comprendre comment la structure, la fonction et la composition des réseaux sociaux des agents peuvent être liées aux idées suicidaires, ainsi qu’aux indicateurs de bien-être.
Stigmatisation et impact
En tant que personne ayant perdu un membre de sa famille immédiate par suicide, et sachant qu’il est impossible de se remettre complètement de la perte d’un être cher par suicide, il était extrêmement important pour moi personnellement que nous représentions les officiers décédés par suicide comme étant plus que de simples statistiques dans une étude de recherche financée par le gouvernement fédéral. Les policiers décédés étaient des individus dont les familles et les amis les aimaient et qui auraient fait tout ce qui était nécessaire pour empêcher le suicide, s’ils l’avaient pu. Compte tenu de la stigmatisation encore associée au suicide, nous avons estimé qu’il était particulièrement important de décrire la vie des officiers de la manière la plus complète possible, afin de décrire la manière dont ils avaient vécu, plutôt que de se concentrer exclusivement sur la manière dont ils étaient morts.
Nous avons également reconnu que, pour ceux qui restent, la perte d’un suicide est différente de tout autre type de décès, et qu’il est extrêmement difficile de décrire les impacts à quelqu’un qui n’est pas passé par là. Néanmoins, nous avons voulu essayer de transmettre les histoires de ces officiers avec une authenticité qui ne peut être relayée que par les mots de ceux qui ont connu la personne décédée le plus intimement.
Afin de donner à ceux qui connaissaient le mieux ces officiers la possibilité de raconter l’histoire de leur proche, nous avons entrepris de trouver et d’interroger les membres de la famille et les amis proches des 20 officiers décédés par suicide au cours de la période que nous avons étudiée. Nous avons utilisé les notices nécrologiques des officiers, accessibles au public, et avons essayé de contacter chacune des personnes citées comme survivantes. Nous avons contacté les parents, les frères et sœurs, les conjoints, les enfants adultes et la famille élargie. Nous avons essayé de trouver des amis proches qui avaient présenté leurs condoléances sur des sites Internet accessibles au public. Le comité d’examen institutionnel de l’université de Northeastern, qui veille à la protection des sujets humains lors des expériences de recherche, a exigé que nous essayions de contacter chaque personne au maximum deux fois, par le biais d’une lettre postée à la dernière adresse connue de la personne, et que nous n’allions pas plus loin tant que nous n’avions pas reçu en retour une communication écrite exprimant un intérêt affirmatif pour un entretien avec l’équipe de recherche.
Compte tenu de ces restrictions, nous craignions que peu de personnes nous répondent et que la portée de nos études de cas se limite à l’examen des dossiers du personnel et d’autres documents fournis par le ministère.
En fait, la réponse à notre démarche auprès des familles a été extraordinaire. En octobre 2019, nous avions reçu des nouvelles des familles et des amis de 17 des 20 officiers. Nous leur sommes profondément reconnaissants d’avoir accepté de nous parler, car même si nos études de cas ne se limitent pas à des entretiens avec la famille et les amis, nous avons estimé que nous ne pourrions rendre pleinement justice à la vie de ces agents que si nous en apprenions également sur eux de la part de leur famille immédiate et de leurs amis. Nous avons compris que, pour certaines familles, la participation était tout simplement trop difficile et l’expérience encore trop douloureuse pour être racontée. Nous les remercions également pour leur correspondance.
Tous nos entretiens ont été menés en personne, souvent au domicile des membres de la famille de l’officier, et nous avons commencé chaque entretien en demandant un souvenir favori de l’officier. Cela a permis aux familles de partager d’abord les expériences positives qu’elles avaient eues avec leur proche. Bien qu’elles n’aient pas été invitées à le faire, la plupart des familles ont apporté des photos, plusieurs nous ont envoyé ou montré des vidéos, et certaines nous ont fait part de choses que leur proche avait écrites. Toutes les familles nous ont donné de riches descriptions de la vie des officiers. L’amour que ces familles et amis portaient aux officiers était tout à fait évident, et la profondeur de leur perte était palpable. Nous avons été touchés par leur volonté de partager les bons souvenirs et de parler à des étrangers de ce qui a souvent été l’événement le plus dévastateur de leur vie. Nous avons quitté les entretiens avec le sentiment d’avoir appris à connaître personnellement ces officiers, même si ce n’est que brièvement. Bien que je n’aie jamais eu l’occasion de rencontrer l’un d’entre eux, je peux évoquer leur image à la vue de leur nom.
Malheureusement, lorsque nous avons interrogé des agents travaillant actuellement pour le département dans le cadre de la deuxième phase de la recherche, nous avons appris que d’autres agents étaient morts par suicide au cours de la période 2010-2015, et nous continuons donc à travailler sur ces études de cas. Bien que nous ne puissions encore rien affirmer de définitif, nous pouvons dire avec un degré de confiance relativement élevé qu’il y avait au moins trois types de cas distincts, et nous pouvons partager certains thèmes préliminaires émergents communs à ces trois types.
Pour être clair, le suicide a été choquant et dévastateur pour toutes les familles avec lesquelles nous avons passé du temps. Cependant, dans le cas de certains agents décédés par suicide, la famille a expliqué qu’il y avait eu des antécédents relativement longs d’anxiété, de dépression, ou les deux. Dans plusieurs cas, il y avait eu des tentatives de suicide antérieures – dans certains cas, les tentatives remontaient à l’adolescence. La famille savait que l’agent était en difficulté et ses membres faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour intervenir. Même dans ces familles, l’événement suicidaire était imprévu et imprévisible.
Prévenir l’inattendu
Dans une série de cas apparentés, il n’y avait pas d’antécédents connus de problèmes de santé mentale, mais les policiers étaient connus pour être en proie à des difficultés personnelles particulièrement graves au moment de leur décès. Ces policiers avaient tendance à être perçus comme stables sur le plan émotionnel et comportemental jusqu’à ce qu’ils soient confrontés à un défi particulièrement important et récent dans leur vie. Bien que ces difficultés aient été dans certains cas clairement liées au travail, plusieurs policiers ayant fait l’objet de mesures disciplinaires ou de rétrogradations, elles étaient le plus souvent d’ordre personnel. Pour presque tous les policiers, les luttes personnelles et professionnelles étaient inextricables.
Plusieurs d’entre eux étaient au milieu de divorces difficiles et de litiges concernant la garde des enfants. Un certain nombre d’entre eux étaient aux prises avec des problèmes croissants de toxicomanie. Certains luttaient contre des douleurs chroniques dues à des blessures, souvent subies au travail. Plusieurs se battaient avec le service pour faire reconnaître les effets persistants de ces blessures professionnelles. Dans ces cas, qui sont à peu près égaux au nombre d’agents ayant des antécédents connus en matière de santé mentale, il y a eu des événements déclencheurs clairs. Ces agents étaient confrontés à une crise existentielle permanente et leurs familles étaient préoccupées, mais généralement pas par le risque de suicide. Souvent, il s’agissait d’officiers qui avaient récemment pris leur retraite ou qui espéraient le faire bientôt.
Enfin, il y a eu une poignée de cas où il n’y avait littéralement aucun signe de lutte préexistante que la famille ou les amis aient pu identifier. Pour la famille, ces suicides semblaient sortir de nulle part et avoir été déclenchés par un seul événement. Nous décrivons ces suicides comme des suicides impulsifs – ces officiers semblent avoir simplement perdu le sens de la mesure à un moment donné, prenant une décision instantanée aux conséquences dévastatrices et durables. Dans ces cas, il y a eu un événement déclencheur, mais aucun des signes précurseurs. Ces agents étaient généralement parmi les plus jeunes, et leur mort est l’une des plus difficiles à comprendre.
Comme on peut déjà s’en douter, il est difficile de généraliser ces cas. Au fur et à mesure que nous avons appris à « connaître » ces agents grâce à notre méthodologie d’étude de cas approfondie, nous nous sommes rendu compte qu’il serait extrêmement difficile de les décrire en termes collectifs sans reconnaître plus de différences que de points communs. En utilisant ce que nous avons appris des familles et des amis pour écrire sur les officiers, très probablement dans un livre que nous prévoyons d’écrire au cours de l’année à venir, nous ferons de notre mieux pour respecter notre engagement de raconter les histoires de la vie des officiers et pas seulement de leur mort.
Recherche sur le bien-être au travail
En juin 2018, nous avons lancé la deuxième phase de cette recherche, qui comprend des entretiens individuels avec des officiers de tous grades qui travaillent actuellement au MADOC. L’entrevue est menée sur leur lieu de travail, pendant leur quart de travail, dans une salle privée avec l’un de nos intervieweurs. Nous avons mené ces entretiens intensifs avec un échantillon aléatoire de plus de 300 officiers dans toutes les installations du MADOC. Nous avons mené près de 100 entretiens supplémentaires avec des agents qui se sont portés volontaires pour nous parler, dont certains connaissaient au moins l’un des agents décédés. En octobre 2019, il ne nous restait plus qu’une poignée d’entretiens à réaliser.
Dans le cadre de ces entretiens, nous posons aux agents des questions sur leur propre santé et leur bien-être. Nous leur posons également des questions sur leurs expériences personnelles en matière de suicide, notamment pour savoir s’ils connaissaient (et dans quelle mesure) l’un des agents décédés par suicide. Nous leur administrons une série d’instruments validés pour évaluer les niveaux d’anxiété, de dépression, de stress post-traumatique et d’idées suicidaires qu’ils déclarent eux-mêmes. Nous leur posons des questions sur leurs habitudes de sommeil et leur consommation d’alcool, sur leur niveau de stress et sur l’importance des conflits dans leur vie professionnelle et familiale. Nous leur demandons ce qu’ils pensent que le département devrait faire pour lutter contre le suicide.
La partie la plus innovante de notre travail de deuxième phase est peut-être notre analyse égocentrique du réseau social – un outil utilisé pour comprendre la structure et la fonction des liens du réseau d’un individu. Nous commençons l’entretien par une série de questions sur les personnes que l’agent connaît, en qui il a confiance ou sur lesquelles il peut compter pour différents types de besoins. Nous posons ensuite des questions sur les personnes citées, notamment sur le degré de connaissance de chacune d’entre elles. Nous espérons que cet aspect de notre étude nous aidera à mieux comprendre la taille, la structure et la densité des réseaux sociaux des agents, ainsi que les fonctions de protection (ou d’isolement) que ces réseaux sociaux peuvent remplir. Nous craignons que les réseaux sociaux de certains policiers deviennent plus restreints et leurs mondes sociaux plus isolés à mesure qu’ils s’intègrent davantage dans le travail correctionnel. Nous sommes particulièrement préoccupés par les effets que le travail posté et certains quarts de travail peuvent avoir sur la vie personnelle et professionnelle des agents. Nous prévoyons que l’analyse des réseaux sociaux ne fera que gagner en importance lorsque nous commencerons à développer une étude longitudinale qui suivra le bien-être des agents au fil du temps (à partir de l’académie).
Promouvoir le bien-être mental
Alors que nous parcourons le pays pour décrire nos recherches et partager ce que nous apprenons, je suis frappée par le nombre de fois où je suis abordée par un agent ou un administrateur d’un service correctionnel d’un autre État qui souhaite partager le fait qu’ils ont eux aussi perdu récemment un nombre disproportionné (et souvent choquant) de collègues à cause d’un suicide. Ces trois dernières années, nous avons appris que ce que nous pensions être une anomalie ne l’était probablement pas du tout.
Nous commençons à peine à analyser les nombreuses données que nous avons recueillies au cours de ces trois dernières années. En 2020, nous espérons pouvoir partager les résultats de cette recherche avec les familles qui ont perdu un être cher, ainsi qu’avec la communauté pénitentiaire et les forces de l’ordre au sens large. Bien que nous soyons convaincus qu’il est presque impossible de prédire le suicide et qu’il est donc extrêmement difficile de le prévenir, nous espérons utiliser nos découvertes pour mieux comprendre certains des facteurs de risque d’anxiété, de dépression, de stress post-traumatique et d’idées suicidaires qui peuvent servir de précurseurs au suicide.
Comme les familles qui ont accepté de nous rencontrer pour partager quelques souvenirs et décrire l’impact dévastateur de la perte de leur mari, femme, fils, fille, père, frère, sœur, oncle ou meilleur ami, nous espérons que ce travail permettra un jour à la famille d’un autre officier de ne jamais avoir à connaître la douleur persistante du suicide.























 Rapports
Rapports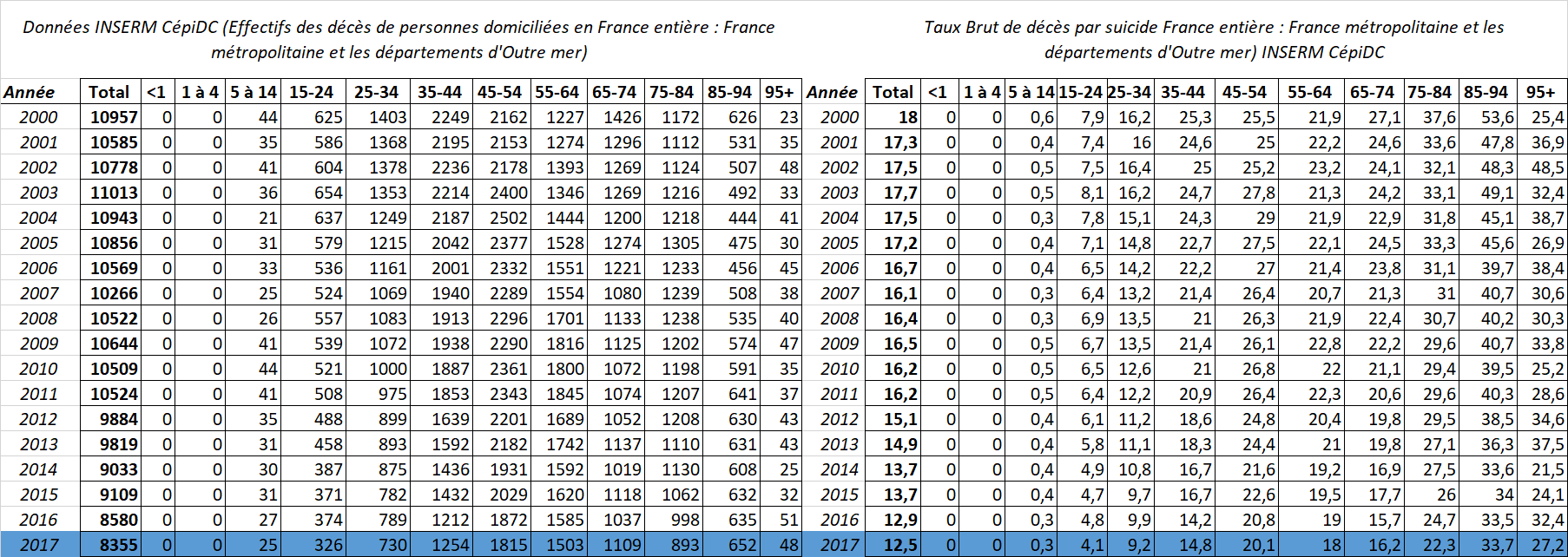
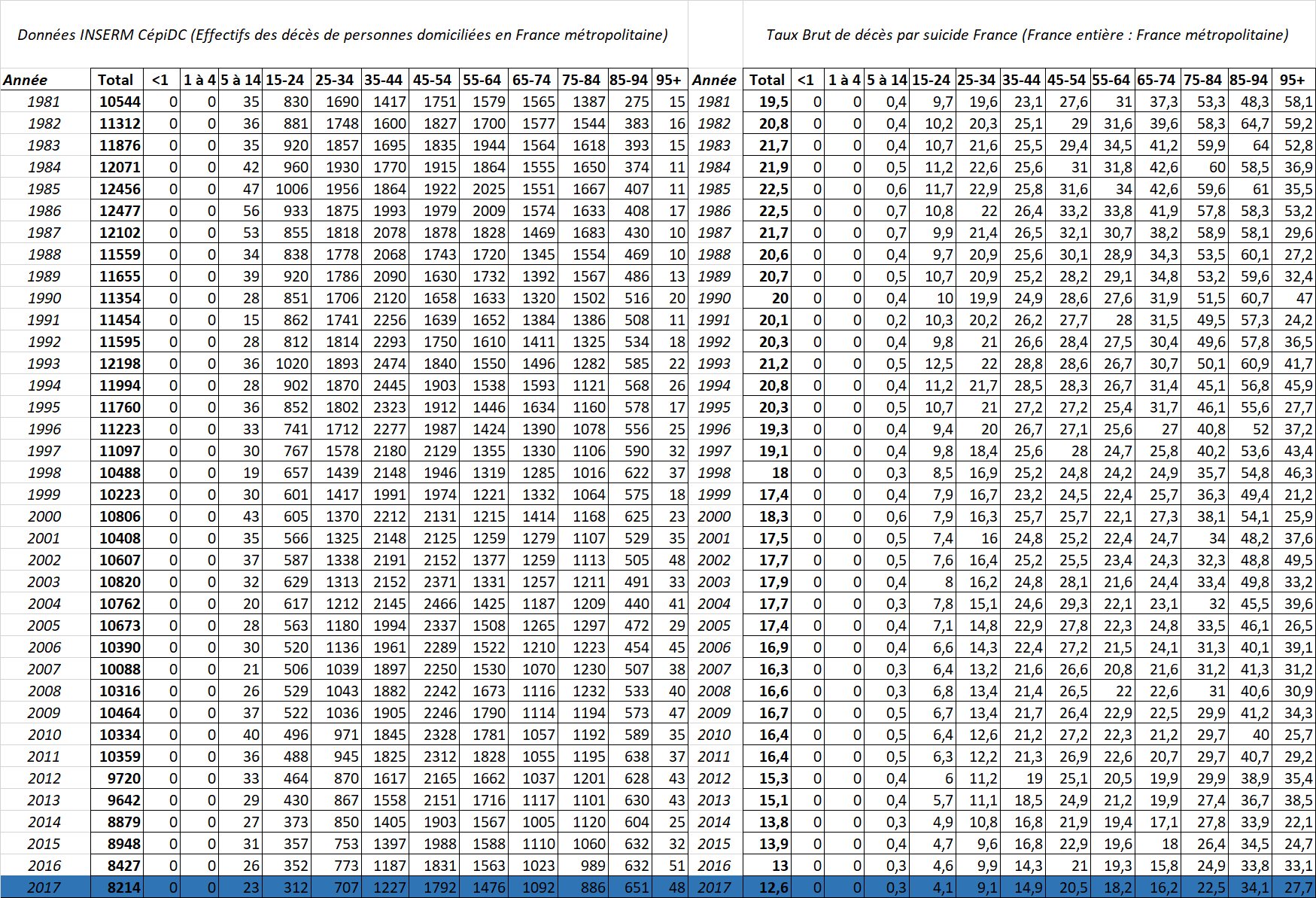

 source
source 

 Geoff Twitchell est un psychologue clinicien agréé (California Board of Psychology 2000) qui a suivi une formation avancée en matière de toxicomanie et de traitement des troubles concomitants. Sa carrière dans le domaine de la toxicomanie a débuté il y a plus de 20 ans, lorsqu’il a travaillé avec le Dr Marc Schuckit (étude longitudinale de l’UCSD sur les facteurs de risque de l’alcoolisme). Le Dr Twitchell a ensuite publié ses travaux de doctorat de l’Université de l’État du Michigan sur les fondements biologiques de l’alcoolisme et la dysrégulation comportementale et affective qui y est associée.
Geoff Twitchell est un psychologue clinicien agréé (California Board of Psychology 2000) qui a suivi une formation avancée en matière de toxicomanie et de traitement des troubles concomitants. Sa carrière dans le domaine de la toxicomanie a débuté il y a plus de 20 ans, lorsqu’il a travaillé avec le Dr Marc Schuckit (étude longitudinale de l’UCSD sur les facteurs de risque de l’alcoolisme). Le Dr Twitchell a ensuite publié ses travaux de doctorat de l’Université de l’État du Michigan sur les fondements biologiques de l’alcoolisme et la dysrégulation comportementale et affective qui y est associée. Melinda (Mindy) Hohman, Ph.D., MSW, est professeur et directrice de l’école de travail social de l’université d’État de San Diego. Elle donne des cours sur le traitement de la toxicomanie, la recherche, l’entretien motivationnel et la pratique du travail social. Elle a publié de nombreux articles sur l’entretien motivationnel, l’évaluation de la toxicomanie et les services de traitement, ainsi que sur les questions relatives aux femmes dans ce domaine. Elle est formatrice en entretien motivationnel (EM) depuis 1999, formant des travailleurs sociaux communautaires, des agents de protection de l’enfance, des agents de probation et des conseillers en toxicomanie dans le sud de la Californie et dans d’autres États. Elle est l’auteur du livre Motivational Interviewing in Social Work Practice. Le Dr Hohman donne chaque année un cours d’étude à l’étranger sur l’abus de substances et la réduction des risques, à Dublin, en Irlande.
Melinda (Mindy) Hohman, Ph.D., MSW, est professeur et directrice de l’école de travail social de l’université d’État de San Diego. Elle donne des cours sur le traitement de la toxicomanie, la recherche, l’entretien motivationnel et la pratique du travail social. Elle a publié de nombreux articles sur l’entretien motivationnel, l’évaluation de la toxicomanie et les services de traitement, ainsi que sur les questions relatives aux femmes dans ce domaine. Elle est formatrice en entretien motivationnel (EM) depuis 1999, formant des travailleurs sociaux communautaires, des agents de protection de l’enfance, des agents de probation et des conseillers en toxicomanie dans le sud de la Californie et dans d’autres États. Elle est l’auteur du livre Motivational Interviewing in Social Work Practice. Le Dr Hohman donne chaque année un cours d’étude à l’étranger sur l’abus de substances et la réduction des risques, à Dublin, en Irlande.

 Le suicide forcé (SF) désigne l’acte ultime d’une victime de violences psychologiques graves et répétées au sein du couple qui ne trouve plus que ce moyen pour sortir de son enfer. Cette notion est mal connue en Europe.
Le suicide forcé (SF) désigne l’acte ultime d’une victime de violences psychologiques graves et répétées au sein du couple qui ne trouve plus que ce moyen pour sortir de son enfer. Cette notion est mal connue en Europe.