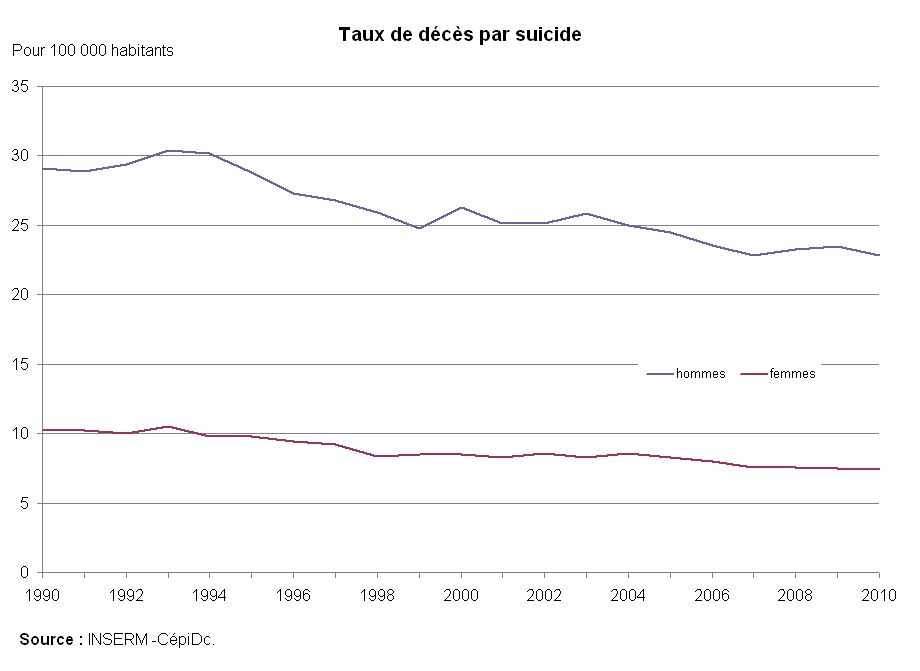Science et Avenir (9 oct 2015) La chirurgie bariatrique entraînerait chez certains patients de graves conséquences psychologiques. Un risque à prendre en compte lors du suivi post-opératoire.
Des personnes obèses ayant subi une chirurgie bariatrique pour perdre du poids ont 50 % plus de probabilité de faire une tentative de suicide qu’avant l’intervention, selon une étude publiée mercredi 7 octobre 2015 dans la revue médicale américaine JAMA Surgery. Les scientifiques ont épluché les dossiers médicaux de 8.815 habitants de la province canadienne d’Ontario (Canada) ayant subi une chirurgie bariatrique entre 2006 et 2011. Ces patients ont été suivis pendant six ans, à savoir trois ans avant et trois ans après l’intervention.
Les tentatives ont lieu 2 à 3 ans après l’intervention
Dans ce groupe, 111 personnes ont été prises en charge aux urgences hospitalières pour 158 tentatives de suicide au total. Les scientifiques ont mis en lumière qu’un tiers avaient eu lieu avant l’intervention et les deux-tiers dans les trois ans l’ayant suivi, soit un accroissement de 50 % du risque. La majorité des tentatives de suicide a été commise par des personnes ayant souffert de troubles mentaux dans le passé, ont constaté les auteurs. De précédentes études avaient déjà montré que les suicides étaient nettement plus fréquents chez les personnes ayant subi cette opération que dans le reste de la population. Elles n’avaient pas déterminé si cela résultait de l’intervention elle-même ou du taux élevé de problèmes mentaux liés à l’obésité. Selon d’autres études, un grand nombre d’obèses ont fait part d’une amélioration de leur moral et de leur estime de soi après cette chirurgie, mais une petite minorité a souffert d’une aggravation de leur dépression et des troubles alimentaires. Les chercheurs canadiens ont souligné que les tentatives de suicide se sont produites pour la plupart entre les deuxième et troisième années après l’opération. Ce qui montre la nécessité d’un suivi plus long de ces patients, ont-ils conclu.
Après l’opération, les habitudes alimentaires doivent changer profondément. Des experts ont avancé que des patients avaient tendance à substituer la nourriture par de l’alcool. Pour d’autres, un pontage gastrique (aussi nommé « bypass gastrique ») pourrait affecter le niveau des hormones et des neurotransmetteurs dans les intestins qui jouent un rôle important pour réguler l’humeur et l’appétit. Aux États-Unis, près de 200.000 interventions bariatriques ont été réalisées en 2014, et plus de 50.000 opérations ont lieu en France chaque année. Elles ont permis d’importantes pertes de poids chez la plupart des obèses ainsi qu’une réduction du diabète adulte dit de type 2 notamment.
Lire la suite de l’article sur le site de science et Avenir
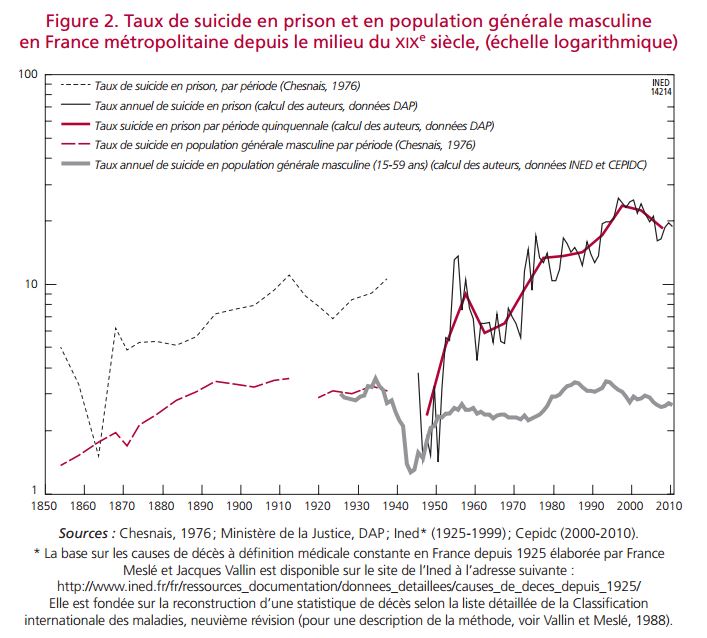

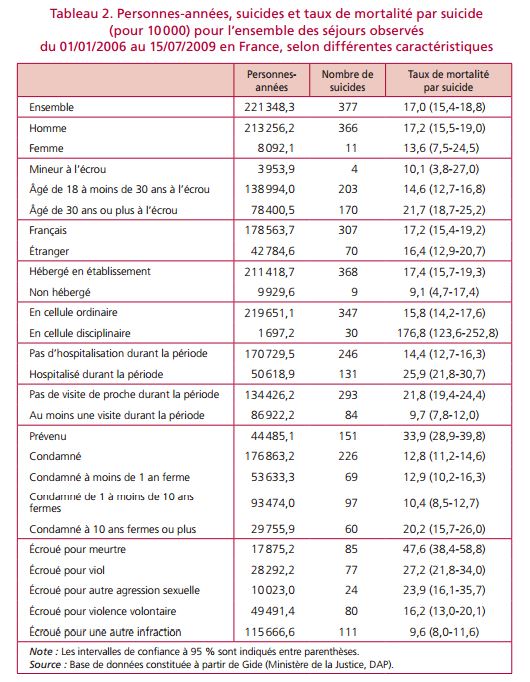
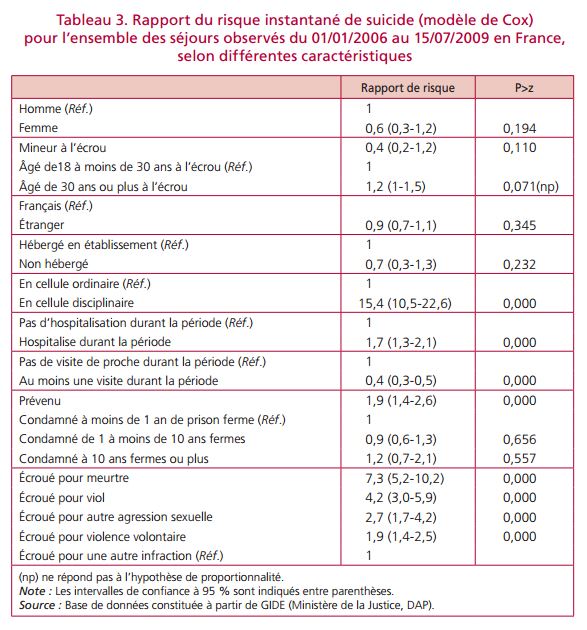
 Résumé:
Résumé: