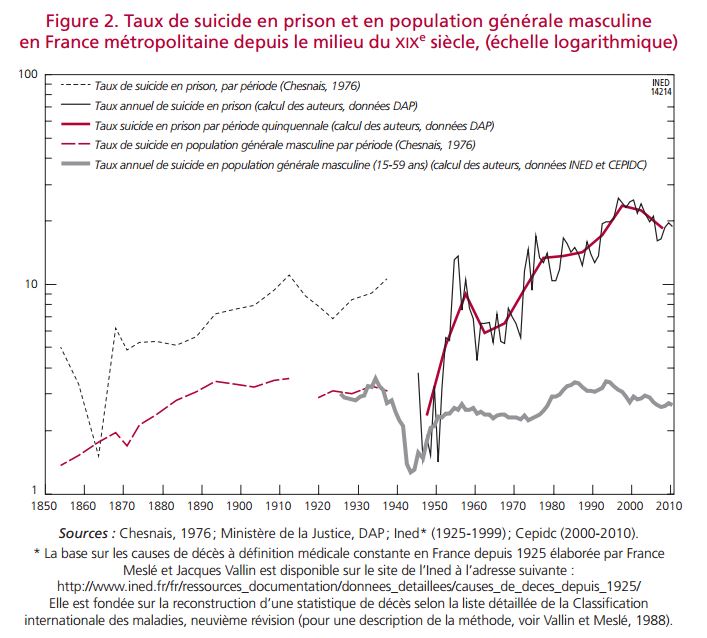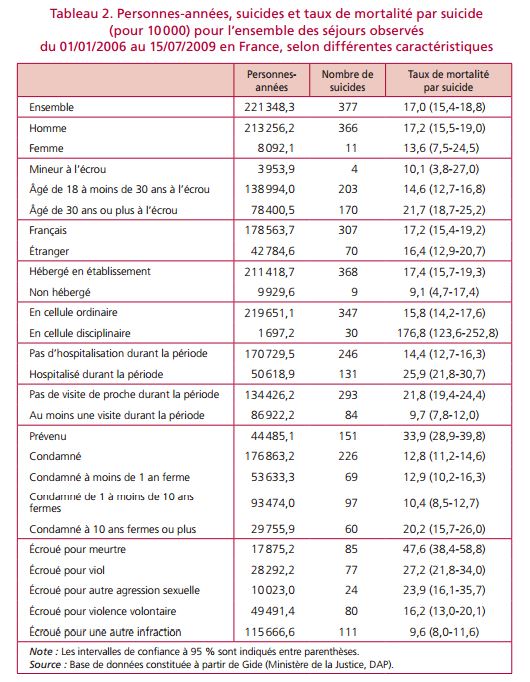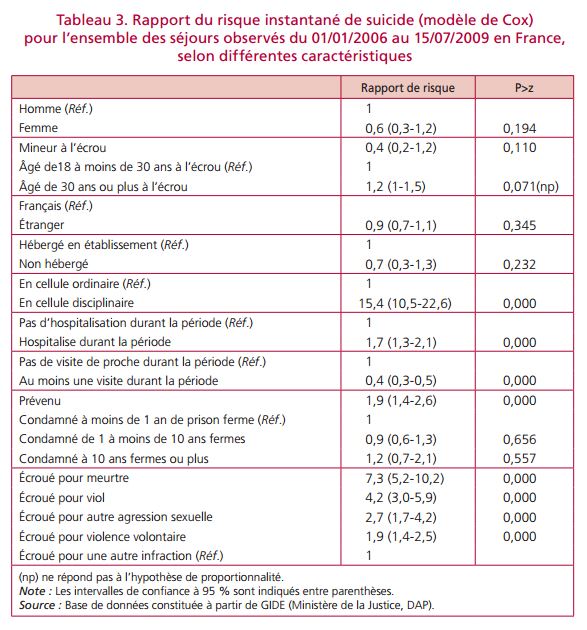Le suicide reste un sujet tabou. Pourtant il est partout : au travail, en fin de vie, avec le terrorisme, à l’adolescence, dans l’expérience amoureuse…

En vertu de notre partenariat avec Philosophie Magazine qui lui consacre un beau papier : je suis ravie de parler du philosophe anglo-saxon Simon Critchley, et de Lettres de suicide, qui paraît ce jour-même en français, et aux éditions Max Milo. Lettres de suicide, le titre nous met sur la voie : oui, Simon Critchley est un philosophe un peu à part, et en 1er lieu parce qu’il est obsédé par la mort, et puis aussi, par l’humour : déjà son essai L’heure et le jour racontait comment il était tombé par hasard sur des thèmes astraux prédisant la mort d’un certain nombre de philosophes, dont la sienne… Dans ces Lettres, c’est donc encore la mort qui l’intéresse, mais la mort non pas malgré soi, mais décidée : le suicide.
Un atelier d’écriture pour comprendre « la preuve la plus irréfutable »
C’est en mai 2013 que Critchley organise, toujours avec humour, un atelier d’écriture sur la lettre d’adieu, « la preuve la plus irréfutable », nous dit-il, « que nous possédions pour comprendre le suicide et la logique fatale de sa vision étroite et bornée ». Hamlet en est le cas d’école, c’est celui qui rabâche de monologue en monologue sa peine profonde, Hamlet, c’est, je cite, le « puissant mélange de dépression et d’exhibitionnisme ». Mais il y a aussi le cas Kurt Cobain façon déclaration de haine, qui fait d’ailleurs référence au personnage shakespearien : « Comme Hamlet, je dois choisir entre la vie et la mort. Je choisis la mort ». Et puis, il y a aussi les lettres d’anonyme qui expliquent leur suicide en raison d’une situation économique impossible, qui en font des lettres de protestation contre le monde, ou encore, et dans la même veine, les lettres qui font du suicide une vengeance politique ou personnelle.
De Hamlet à Kurt Cobain, comment parler du suicide sans morale ?
Autant de lettres et autant d’explications donc, de raisons pour tenter de comprendre ce qui conduit au suicide, car là est bien la question qui guide Critchley : peut-on parler philosophiquement du suicide comme d’un phénomène comme un autre ? Sans faire intervenir ni le droit ni la morale ? Pourquoi même la philosophie qui nous apprend à mourir condamne-t-elle le suicidaire à être irresponsable ou fautif ? Et si les philosophes eux-mêmes n’étaient pas émancipés de la morale, voilà ce qui apparaît au long de ses pages, des philosophes qui se tiennent toujours au seuil de la pure liberté et ne parviennent pas à passer à l’action, à se décider sans raison.
 Ce recueil numérique propose une sélection bibliographique sur la thématique du suicide. Il est composé de références à des ouvrages, des études et des rapports, d’une part, et à des articles scientifiques, d’autre part. Il comporte également d’autres types d’informations en lien avec le suicide : des colloques, des sites Web institutionnels et associatifs et des émissions de radio et de télévision.
Ce recueil numérique propose une sélection bibliographique sur la thématique du suicide. Il est composé de références à des ouvrages, des études et des rapports, d’une part, et à des articles scientifiques, d’autre part. Il comporte également d’autres types d’informations en lien avec le suicide : des colloques, des sites Web institutionnels et associatifs et des émissions de radio et de télévision.