 La période choisie est décisive, d’abord parce que le suicide change de statut juridique, passant de l’incrimination à la dépénalisation, parce qu’il s’agit d’une époque d’évolution rapide des mentalités et l’enquête de Dominique Godineau se présente aussi comme une histoire culturelle et politique des sensibilités, mais également parce que les contemporains ont eu le sentiment, à tort ou à raison, que l’époque connaissait une recrudescence de l’homicide de soi-même, en particulier sous la Révolution, et enfin parce que le mot suicide, importé d’Angleterre, un pays réputé terre d’élection de la mort volontaire, fait son entrée dans le vocabulaire français à cette époque. Le néologisme, forgé à partir du latin au XVIIe siècle, assemble sui, de soi et caedes, devenu cide, meurtre, le suffixe qu’on retrouve dans homicide, parricide ou régicide.
La période choisie est décisive, d’abord parce que le suicide change de statut juridique, passant de l’incrimination à la dépénalisation, parce qu’il s’agit d’une époque d’évolution rapide des mentalités et l’enquête de Dominique Godineau se présente aussi comme une histoire culturelle et politique des sensibilités, mais également parce que les contemporains ont eu le sentiment, à tort ou à raison, que l’époque connaissait une recrudescence de l’homicide de soi-même, en particulier sous la Révolution, et enfin parce que le mot suicide, importé d’Angleterre, un pays réputé terre d’élection de la mort volontaire, fait son entrée dans le vocabulaire français à cette époque. Le néologisme, forgé à partir du latin au XVIIe siècle, assemble sui, de soi et caedes, devenu cide, meurtre, le suffixe qu’on retrouve dans homicide, parricide ou régicide.
Montesquieu, comme Voltaire ou Beccaria, l’auteur du célèbre traité Des délits et des peines, s’inquiétaient de la férocité de la loi concernant les suicidés. « On les fait mourir, pour ainsi dire, une deuxième fois » écrit Usbek, le protagoniste des Lettres persanes et Voltaire s’engagea à deux reprises dans des affaires où le suicide était l’élément déclencheur : comme il n’avait pas déclaré celui de son fils pour éviter la honte du procès, Calas, accusé de l’avoir tué était mort sur la roue et Sirven avait également été poursuivi pour le meurtre de sa fille qui s’était jetée dans un puits. Sous l’Ancien Régime, le suicide fait partie des crimes, comme celui de lèse-majesté divine ou humaine, où la mort du prévenu ne suffit pas à éteindre les poursuites et où l’on peut faire un procès au cadavre, lequel est même écroué le temps de la procédure au grand dam des autres prisonniers incommodés par les pestilences de la putréfaction, et représenté au tribunal par un « curateur ». La peine, à la fois physique, symbolique et pécuniaire consiste pour le corps à être traîné sur une claie la tête en bas, au niveau du caniveau puis pendu par les pieds et ainsi exposé 24 heures, sa mémoire effacée et ses biens confisqués, même si des aménagements ont progressivement permis à la famille, femme et enfants, d’en conserver une partie. Il était fait obligation à quiconque découvrait un cadavre d’en aviser les autorités, et même aux proches. C’est pourquoi les parents, ainsi que le curateur désigné, avaient tout intérêt à plaider la folie, l’accident ou l’homicide maquillé en suicide quand c’était possible.
Le procès fait à un mort et instruit, selon l’expression consacrée, « en la forme ordinaire », prenait vite l’apparence du « non sense » et de l’absurde. Au cours de la confrontation le juge, comme il se doit, demandait aux témoins s’ils reconnaissaient l’accusé dans la personne du curateur qu’ils voyaient pour la première fois. Lorsque le cadavre était présenté aux témoins après la confrontation, ceux-ci ne savaient plus très bien s’ils devaient reconnaître l’accusé ou sa victime. Parfois le curateur devait se rendre en prison à l’énoncé de la sentence pour que celle-ci soit lue dans les règles. Et lorsqu’un procureur faisant preuve d’humanité dans le cas, par exemple, d’un jeune valet de ferme retrouvé pendu à une branche de chêne, orphelin tranquille et aux dires des témoins assez triste et regrettant la maison familiale, s’il voulait l’absoudre au bénéfice d’un doute improbable – a-t-il été étranglé avant d’être pendu – il ne pouvait en aucun cas évoquer la tristesse du jeune homme car elle était considérée comme un élément à charge.
Heureusement, la majorité des suicides ne donnait pas lieu à un procès. Comment établir en l’absence de témoins qu’une noyade est un suicide ? La position sociale constituait également une puissante protection. Aristocrates et membres du clergé pouvaient facilement s’y soustraire. Le tout venant des morts volontaires était en majorité des domestiques, la moitié au chômage ayant perdu leur identité sociale. Beaucoup de militaires, aussi et l’éventail complet des activités sociales. Un cas emblématique de ce siècle dit « des Lumières », par l’écho qu’il a eu même à l’étranger concerne le suicide « philosophique » de deux jeunes et beaux dragons le jour de Noël 1773, qui se brûlent la cervelle après avoir ripaillé de saucisses, boudin et pâté arrosés de trois bouteilles de champagne en bavardant avec la patronne et plaisantant avec la servante. Dans le « testament philosophique » qu’ils signent conjointement ils disent leur dégoût « de la scène universelle » en invitant les hommes à se défaire de leurs préjugés, notamment ceux qui concernent la mort, assurant « qu’il est aussi aisé de renoncer à l’existence que de quitter un habit dont la couleur nous déplaît ». L’affaire fera grand bruit, les Anti-Lumières s’en emparent pour dénoncer les ravages de la moderne philosophie et les deux militaires finiront au poteau d’infamie à l’issue de l’un des derniers procès du genre.
L’acte puissamment symbolique dénote une évolution des mentalités soutenue en effet par les philosophes. Dans son Système de la nature, d’Holbach défend le droit au suicide et David Hume publie son Essai sur le suicide, très vite traduit en français, même s’il réfute le précédent, la dispute étant en bonne logique la meilleure manière d’exposer les arguments de l’adversaire. Rousseau et Sade y mettront du leur et dans un autre registre, tournant le regard vers le romantisme naissant, Goethe donne à lire le roman de la mort volontaire avec Les souffrances du jeune Werther, disponible dans notre langue dès 1776. L’esprit de la Révolution complètera l’édifice, en associant l’amour de la liberté à la mort reçue ou choisie dans le combat sans merci contre la tyrannie. L’auteur ne dit pas si, de la prise de la Bastille à Thermidor en passant par la Terreur, le nombre des suicides, réputé à la hauteur de la succession rapide des événements, a toisé celui des charrettes.
Jacques Munier
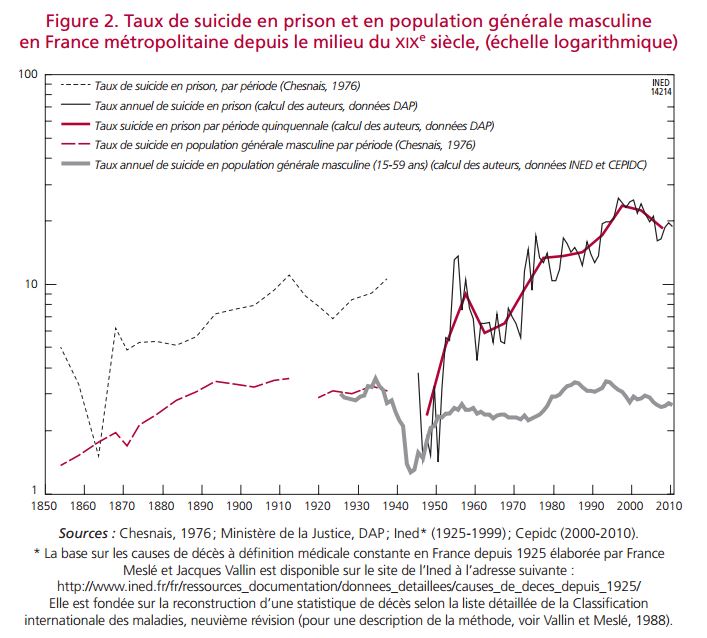

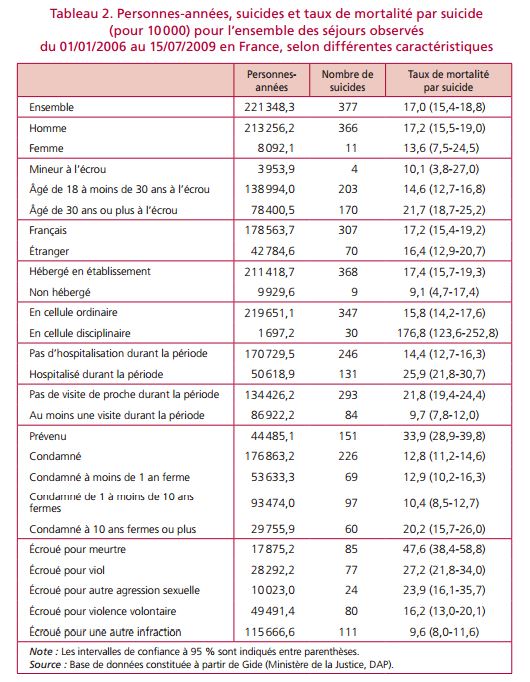
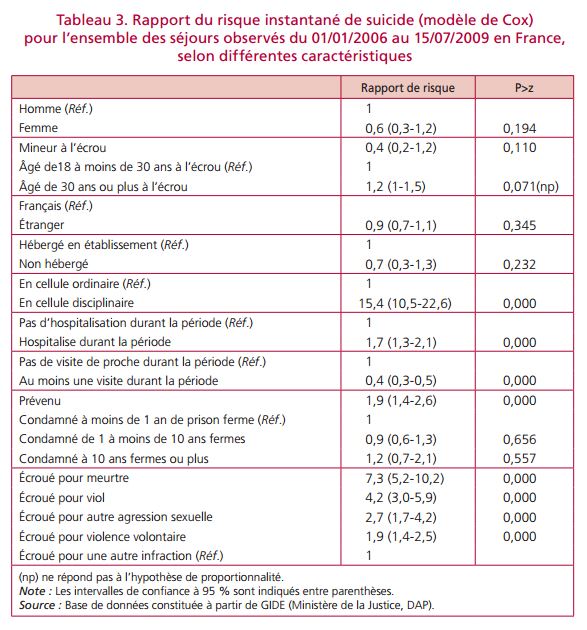



 For many years Sergeant Kevin Briggs had a dark, unusual, at times strangely rewarding job: He patrolled the southern end of San Francisco’s Golden Gate Bridge, a popular site for suicide attempts. In a sobering, deeply personal talk Briggs shares stories from those he’s spoken — and listened — to standing on the edge of life. He gives a powerful piece of advice to those with loved ones who might be contemplating suicide.
For many years Sergeant Kevin Briggs had a dark, unusual, at times strangely rewarding job: He patrolled the southern end of San Francisco’s Golden Gate Bridge, a popular site for suicide attempts. In a sobering, deeply personal talk Briggs shares stories from those he’s spoken — and listened — to standing on the edge of life. He gives a powerful piece of advice to those with loved ones who might be contemplating suicide. La période choisie est décisive, d’abord parce que le suicide change de statut juridique, passant de l’incrimination à la dépénalisation, parce qu’il s’agit d’une époque d’évolution rapide des mentalités et l’enquête de Dominique Godineau se présente aussi comme une histoire culturelle et politique des sensibilités, mais également parce que les contemporains ont eu le sentiment, à tort ou à raison, que l’époque connaissait une recrudescence de l’homicide de soi-même, en particulier sous la Révolution, et enfin parce que le mot suicide, importé d’Angleterre, un pays réputé terre d’élection de la mort volontaire, fait son entrée dans le vocabulaire français à cette époque. Le néologisme, forgé à partir du latin au XVIIe siècle, assemble sui, de soi et caedes, devenu cide, meurtre, le suffixe qu’on retrouve dans homicide, parricide ou régicide.
La période choisie est décisive, d’abord parce que le suicide change de statut juridique, passant de l’incrimination à la dépénalisation, parce qu’il s’agit d’une époque d’évolution rapide des mentalités et l’enquête de Dominique Godineau se présente aussi comme une histoire culturelle et politique des sensibilités, mais également parce que les contemporains ont eu le sentiment, à tort ou à raison, que l’époque connaissait une recrudescence de l’homicide de soi-même, en particulier sous la Révolution, et enfin parce que le mot suicide, importé d’Angleterre, un pays réputé terre d’élection de la mort volontaire, fait son entrée dans le vocabulaire français à cette époque. Le néologisme, forgé à partir du latin au XVIIe siècle, assemble sui, de soi et caedes, devenu cide, meurtre, le suffixe qu’on retrouve dans homicide, parricide ou régicide.